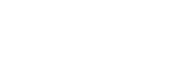Jardin Botanique
A propos de cet espace vert
Le jardin Botanique est aujourd’hui un parc urbain pris en étau dans le tissu routier du quartier nord de Bruxelles. De sa vocation première de jardin botanique, il conserve un mélange de styles (français, italien, anglais) et une grande variété d’arbres et de plantes.
S’étendant sur plus de 6 ha, ce parc aménagé en terrasses fut inauguré en 1829. La terrasse la plus haute, au pied de l’orangerie, est de construction géométrique à la française.
L’étage intermédiaire, à la mode italienne, comporte une roseraie en étoile et le jardin de l’Iris où fleurissent, d’avril à juin, quelque 40 variétés d’iris, symbole de la Région de Bruxelles-Capitale.
La dernière partie du jardin descend en pente douce vers l’étang par des sentiers sinueux. Les pelouses sont parsemées d’arbres et encadrent des aires de repos.
Infos pratiques
Heures d’ouverture
Le parc est ouvert au public tous les jours, selon l’horaire suivant:
- du 01 octobre au 31 mars, de 08h30 à 17h15,
- du 01 au 30 avril, de 08h30 à 18h15,
- du 01 mai au 31 août, de 08h30 à 20h15,
- du 01 au 30 septembre, de 08h30 à 19h15.
En raison du temps nécessaire pour vérifier tous les accès et chemins du parc, dernière entrée 15 minutes avant la fermeture.
Présence régulière des gardiennes et gardiens de parc.
Une question, un problème?
- Pendant les heures de surveillance, adressez-vous aux gardiennes ou gardiens de parc.
- Pendant les heures de bureau, Bruxelles Environnement : 02 775 75 75 ou info@environnement.brussels.
- En cas d’urgence, zone de Police Bruxelles Nord : 02 249 22 11.
Entrées
Implanté à Saint-Josse-Ten-Noode le long du boulevard qui porte son nom, le jardin Botanique est accessible par la rue Royale, le boulevard Saint-Lazare, la rue Gineste et la rue Botanique.
Transports en commun
BUS : 218 (arrêt(s) : Saint-Louis) - 204 (arrêt(s) : Botanique, Gillon) - 65, 66 (arrêt(s) : Rue Traversière) - 61 (arrêt(s) : Botanique, Rogier, Rue Traversière, Saint-Louis) - 58 (arrêt(s) : Rogier)
METRO : 2, 6 (arrêt(s) : Botanique, Rogier)
TRAM : 92, 93 (arrêt(s) : Botanique, Gillon) - 25, 3, 32, 4, 55 (arrêt(s) : Rogier)
Aménagements
-
Accès pour personne à mobilité réduite
-
équipements sportifs
-
Fontaine d'eau potable
-
Plaine de jeux
Le site est clôturé. Bancs et poubelles. Le parc dispose d’une plaine de jeux pour les petits et d’un terrain multisports (goals, panneaux de basket + marquage au sol pour le tennis et le volley-ball) rue du Botanique. Ces infrastructures se trouvant à l’extérieur de la clôture, elles restent accessibles en dehors des heures de fermeture du jardin.
Nature
Histoire
Le tout premier jardin botanique de Bruxelles se situait rue de Ruysbroeck dans le jardin de l’ancien palais de Charles de Lorraine où était alors installée une école supérieure.
En 1826, l’agrandissement de la Bibliothèque royale et d’autres transformations urbanistiques, comme la démolition des remparts de la ville menacent son existence. Pour sauver ce qui peut l’être, une société d’amateurs, « La Société royale d’Horticulture des Pays-Bas », décide de financer la création d’un nouveau jardin botanique en bordure de la ville, à Saint-Josse-Ten Noode. Les 6 ha 37 a de terrain sont aménagés en terrasses selon les plans de l’architecte de jardin Charles-Henri Petersen, remaniés ensuite par l’un des fondateurs de la Société d’Horticulture, Jean-Baptiste Meeus-Wouters. Ils seront inaugurés en septembre 1829.
Malgré une subvention gouvernementale accordée annuellement à partir de 1837, les gestionnaires du jardin accumulent les problèmes financiers. Pour y faire face, ils vendent une partie du terrain pour la construction de la gare du Nord et s’adonnent au commerce des plantes. La vocation initiale didactique et scientifique du jardin est menacée.
L’Etat belge décide donc en 1870 de le racheter et de garantir à la fois son panorama, sa vocation scientifique et son statut de promenade publique. Ce sera l’âge d’or du jardin qui ne cessera de s’enrichir. Chaque terrasse aura son style : à la française, en haut, italien au milieu, à l’anglaise dans le fond. C’est de cette époque que datent l’ajout des sculptures, des ornements, des rocailles, de la serre…
De nouveaux projets urbanistiques, comme la jonction Nord-Midi et surtout l’exigüité des lieux en regard de toutes collections horticoles rassemblées au fil des années condamnent le maintien du jardin Botanique à Bruxelles. Son transfert à Meise se fera en 1939.
L’aura du Jardin Botanique n’est plus ce qu’elle était. Au départ des collections, succèdent les dégâts survenus au cours du deuxième conflit mondial, puis les amputations nécessaires à l’aménagement de la petite ceinture, à la création du boulevard Saint-Lazare (qui coupe le jardin en deux) et à l’élargissement de la rue Gineste.
En 1958, pour l’exposition universelle, l’architecte paysagiste bruxellois René Pechère réaménage le jardin. Son but : préserver les grandes lignes de la structure ancienne et les arbres remarquables, harmoniser les nouvelles interventions à l’architecture des bâtiments existants et asseoir la vocation d’espace public urbain du jardin.
Malgré cela, et malgré le classement du site, le Jardin Botanique ne retrouvera pas son lustre d’antan. L’urbanisation du quartier, l’arrivée du métro, la construction de la cité administrative et le vandalisme perturberont petit à petit l’écosystème du jardin.
Depuis 1991, date à laquelle la gestion du jardin Botanique a été transférée à la Région de Bruxelles-Capitale, la restauration progressive du jardin se poursuit.
Patrimoine
Monuments
L’orangerie
Aménagée entre 1826 et 1829 d’après les plans de Pierre-François Gineste, plans qui s’inspiraient du projet plus ambitieux de Tilman-François Suys. Construit tout en haut du jardin, et profitant de la déclivité du terrain pour échelonner ses verrières vers le sud, le complexe architectural abritait des serres, des locaux administratifs et des locaux scientifiques. L’élément remarquable du bâtiment est sans conteste la rotonde centrale à coupole.
Entre 1842 et 1854, l’orangerie fut agrandie à plusieurs reprises (construction d’un portique rue Royale, d’une salle des fêtes…). En 1978, le Ministère de la Communauté française hérite du bâtiment à l’abandon et décide d’en faire un centre culturel.
Les travaux de rénovation seront confiés à l’Atelier 20 et les activités culturelles du « Botanique » débuteront en janvier 1984.
Sculptures
52 sculptures en bronze décoraient le jardin Botanique à la fin du 19e siècle. Elles avaient été commandées en 1893 par le ministre de l’Intérieur Jules de Burlet aux sculpteurs Constantin Meunier et Charles Van der Stappen dans l’optique d’embellir la ville et d’encourager officiellement la création artistique.
Ceux-ci imaginèrent des fontaines, des candélabres et des sculptures s’inspirant de sujets animaliers, botaniques ou en référence aux saisons. Ils réalisèrent les maquettes de leurs projets et confièrent la réalisation de toutes ces œuvres aux artistes connus de l’époque : Victor De Haen, Léon Mignon, Jules Lagae, Alphonse de Tombay, Pierre Braecke, Emile Namur, Pierre-François Rude…
30 de ces 52 sculptures sont encore dans le jardin aujourd’hui (les autres ont soit été transportées à Meise, soit ont tout simplement disparu). Citons : Les quatre âges, l’Eté ou le moissonneur, l’Aigle, le Serpent et le caïman, l’Olivier ou la paix, Deux nymphes entourant une source, le Souci, le Lierre, la Panthère…
De facture plus récente, « La jeune fille sauvée des eaux » est la seule sculpture en pierre du jardin. Elle se trouve au milieu du bassin du jardin de l’Iris.
Infos pratiques
Heures d’ouverture
Le parc est ouvert au public tous les jours, selon l’horaire suivant:
- du 01 octobre au 31 mars, de 08h30 à 17h15,
- du 01 au 30 avril, de 08h30 à 18h15,
- du 01 mai au 31 août, de 08h30 à 20h15,
- du 01 au 30 septembre, de 08h30 à 19h15.
En raison du temps nécessaire pour vérifier tous les accès et chemins du parc, dernière entrée 15 minutes avant la fermeture.
Présence régulière des gardiennes et gardiens de parc.
Une question, un problème?
- Pendant les heures de surveillance, adressez-vous aux gardiennes ou gardiens de parc.
- Pendant les heures de bureau, Bruxelles Environnement : 02 775 75 75 ou info@environnement.brussels.
- En cas d’urgence, zone de Police Bruxelles Nord : 02 249 22 11.
Entrées
Implanté à Saint-Josse-Ten-Noode le long du boulevard qui porte son nom, le jardin Botanique est accessible par la rue Royale, le boulevard Saint-Lazare, la rue Gineste et la rue Botanique.
Transports en commun
BUS : 218 (arrêt(s) : Saint-Louis) - 204 (arrêt(s) : Botanique, Gillon) - 65, 66 (arrêt(s) : Rue Traversière) - 61 (arrêt(s) : Botanique, Rogier, Rue Traversière, Saint-Louis) - 58 (arrêt(s) : Rogier)
METRO : 2, 6 (arrêt(s) : Botanique, Rogier)
TRAM : 92, 93 (arrêt(s) : Botanique, Gillon) - 25, 3, 32, 4, 55 (arrêt(s) : Rogier)